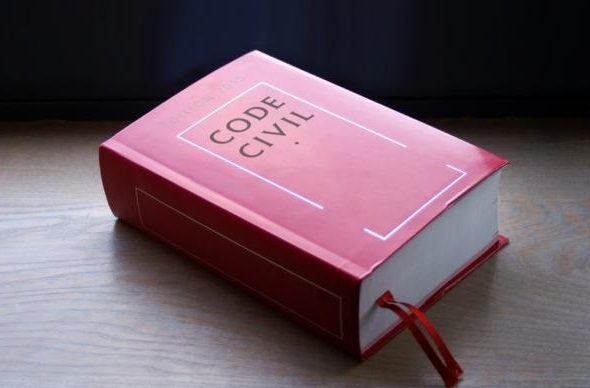L'achat d'un bien immobilier est souvent le projet d'une vie, mais il s'accompagne d'une crainte universelle : celle de découvrir un défaut majeur une fois les clés en main.
Pour s'en prémunir, les vendeurs intègrent quasi systématiquement une "clause de non-garantie des vices cachés" dans l'acte de vente. Cette mention, censée les protéger contre tout recours ultérieur, peut sembler décourageante pour l'acheteur.
Pourtant, cette protection est loin d'être absolue. La loi et la jurisprudence ont tissé un filet de sécurité qui recèle des exceptions surprenantes, rééquilibrant le pouvoir en faveur de l'acquéreur vigilant et informé.
Pour qu'un défaut soit légalement reconnu comme un vice caché au sens de l'article 1641 du Code civil, il doit remplir trois conditions strictes : il doit être antérieur à la vente, suffisamment grave pour rendre le bien impropre à son usage normal, et bien sûr, non apparent lors d'un examen attentif par un acheteur non professionnel. C'est sur ce socle que reposent les protections de l'acheteur, même lorsque le contrat tente de les écarter.
1. La fameuse clause "vendu en l'état" : une protection en trompe-l'œil
La clause d'exclusion de garantie des vices cachés, systématique dans les ventes entre particuliers, n'est pas une armure infaillible pour le vendeur. La loi prévoit en effet deux situations majeures où cette clause est tout simplement écartée, laissant l'acheteur en position de force.
• Le vendeur est un professionnel : selon l'article 1643 du Code civil, un vendeur professionnel (promoteur, marchand de biens) ne peut jamais s'exonérer de cette garantie. La loi présume qu'il connaît ou devrait connaître, les défauts du bien qu'il vend. La jurisprudence a d'ailleurs une conception large de cette notion. Par exemple, une SCI patrimoniale dont l'objet est l'acquisition et la gestion de biens a déjà été assimilée à un vendeur professionnel par les juges (Cour de cassation, 3e civ., 27 octobre 2016, nᵒ 15-24.232).
La clause est donc sans effet.
• Le vendeur est de mauvaise foi : si l'acheteur parvient à prouver que le vendeur particulier connaissait l'existence du vice avant la vente et l'a volontairement dissimulé, la clause est aussi sans effet. La mauvaise foi peut être démontrée, par exemple, par des travaux de camouflage, comme le colmatage de fissures suivi d'un ravalement de façade juste avant la mise en vente (Cour de cassation, 3e civ., 7 mars 2024, nᵒ 20-17790). Dans ce cas, l'article 1645 du Code civil est très clair : l'acheteur peut non seulement demander l'annulation de la vente ou une réduction du prix, mais également exiger des dommages et intérêts pour le préjudice subi.
2. Le vendeur "bricoleur" peut être considéré comme un constructeur.
Voici une subtilité juridique particulièrement redoutable pour les vendeurs qui ont réalisé eux-mêmes des travaux importants. Lorsque les rénovations effectuées par le vendeur sont à l'origine du vice caché, la justice présume qu'il avait connaissance du défaut. La clause de non-garantie est alors écartée, car le vendeur est présumé de mauvaise foi (Cass. civ. 3e, 10 juillet 2013, n° 12-17.149).
Cette règle protège efficacement l'acheteur des rénovations réalisées par des amateurs qui, sous une apparence correcte, peuvent masquer de graves problèmes structurels.
Plus surprenant encore, si les désordres sont graves et affectent la solidité de l'ouvrage (comme des problèmes de charpente ou de fondations), l'acheteur peut contourner la garantie des vices cachés pour invoquer la garantie décennale, prévue par l'article 1792 du Code civil. Le vendeur-bricoleur est alors assimilé à un constructeur et se retrouve tenu par une garantie beaucoup plus lourde, valable dix ans à compter de la réception des travaux.
3. La sanction peut dépasser largement le prix de la maison.
Les conséquences pour un vendeur de mauvaise foi peuvent être financièrement dévastatrices. La loi distingue l'action visant à annuler la vente (action rédhibitoire) ou à réduire le prix (action estimatoire) de l'action en dommages et intérêts. Cette dernière est autonome et peut s'y ajouter.
Une affaire jugée par la Cour de cassation illustre parfaitement la sévérité de la sanction. Des acquéreurs avaient acheté une maison fissurée pour 98 000 €. Après expertise, il s'est avéré que la seule solution était de démolir et de reconstruire. Ils ont obtenu en justice une indemnisation équivalente au coût total de ces opérations, un montant qui dépassait largement le prix d'achat initial.
L'action indemnitaire, ouverte en cas de mauvaise foi du vendeur, est autonome par rapport à l’action rédhibitoire et à l'action estimatoire. Dans ces conditions, les dommages et intérêts perçus peuvent dépasser largement le prix de vente. La sanction est donc très sévère pour le vendeur de mauvaise foi.
4. Un défaut "visible" peut quand même être un vice "caché".
La distinction entre un vice apparent, non couvert par la garantie, et un vice caché peut sembler évidente. Pourtant, la jurisprudence est plus nuancée. Un vice apparent est celui qu’un acheteur non professionnel est censé pouvoir déceler.
Cependant, des défauts visibles, comme des fissures, peuvent être requalifiés en vices cachés si un acheteur profane ne pouvait pas en mesurer la cause, l'ampleur et les conséquences graves sans l'intervention d'un expert. Dans une affaire récente (Cour de cassation, 3e civ., 14 septembre 2023, n° 22-16.623), des acquéreurs avaient bien vu des fissures avant d'acheter. Les juges ont néanmoins considéré qu'il s'agissait d'un vice caché, car, n'étant pas des professionnels du bâtiment, ils ne pouvaient se convaincre de la gravité du problème (une inadaptation des fondations au sol) et de son caractère évolutif.
5. Le vendeur n’est pas toujours le seul à pouvoir être mis en cause
En cas de litige, la responsabilité du vendeur peut être partagée avec les professionnels qui sont intervenus dans la transaction. Le notaire et l'agent immobilier sont, en effet, tenus à un devoir d'information et de conseil envers l'acquéreur.
La jurisprudence a ainsi retenu la responsabilité :
• D'un notaire qui, bien qu'ayant mentionné, dans l'acte de vente, un jugement antérieur relatif à des fissures, avait manqué à son devoir en omettant de joindre la décision au dossier. L'annexion de ce document aurait permis aux acquéreurs de comprendre la réelle gravité du sinistre.
• D'un agent immobilier qui s'était contenté de mentionner dans la promesse de vente un "sinistre résolu" sans chercher à obtenir plus d'informations ou de justificatifs auprès du vendeur.
Dans cette affaire, les juges ont estimé que ces manquements avaient contribué au préjudice de l'acheteur et ont fixé leur part de responsabilité à 10 % des dommages et intérêts dus par le vendeur.